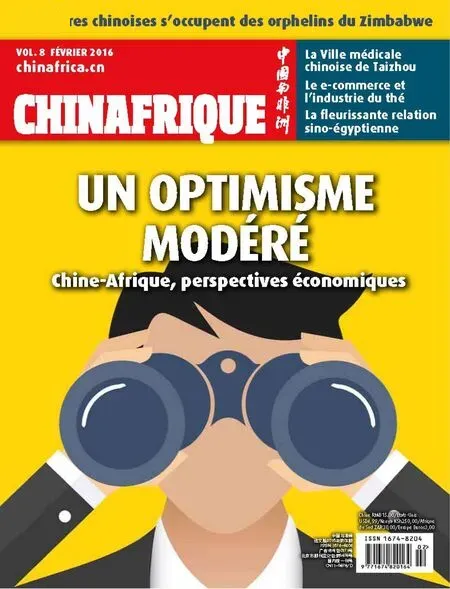Les langues naissent, vieillissent et meurent
par Lisa Carducci
Les langues naissent, vieillissent et meurent
par Lisa Carducci
LE certificat de naissance de la langue française, peut-on dire, ce sont les Serments de Strasbourg. L’empire de Charlemagne était devenu si vaste – donc ingouvernable – que l’empereur décida, en 842, de le partager entre ses trois petits-fils. Charles règnerait sur le domaine franc, et Louis sur la région germanique. Lothaire, qui héritait de la partie intermédiaire, jusqu’à l’ltalie, était mécontent de son lot et devenait menaçant. Ses deux frères se prêtèrent donc serment d’alliance en cas d’attaque. L’engagement fut lu en langue romane et en langue germanique.
Voici donc la première phrase en langue romane (qui n’est déjà plus du latin) : Pro deo amur et pro Christian poblo et nostro commun salvament d’ist di in avant in quant deus savir et podir me dunat si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna cosa si cum om per dreit son fradra salvar dist in o quid il mi altresi fazet… On y reconnait : « Pour l’amour de Dieu et du peuple chrétien et notre salut commun, de ce jour et en avant (d’ores et en avant, dorénavant), en autant que Dieu savoir et pouvoir me donne, je sauverai ce mon frère Karlo et en aide et en chaque chose, comme par droit son frère on doit sauver, en autant qu’il me fasse de même… » C’était la langue française de la fin de la période féodale. Le français est issu du latin vulgaire (langue du peuple) et non du latin classique.
De là naîtront de nombreux patois et dialectes. On divise les dialectes du nord et du sud selon le terme employé pour dire « oui » ou « c’est cela », soit hoc ille (oil) ou hoc (oc). Le nom Languedoc vient de « langue d’oc ».
Suit une francisation intense du latin (période du moyen français) du XlVeau XVlesiècle, avec des reculs, des arrêts, et des oppositions.
Parmi tous les dialectes du français, le roi François lerimpose, en 1539, le françoys ou « langue du roi » (on prononçait rouè) comme langue officielle. Le françoys est donc introduit dans diverses sciences ; on n’écrit plus en latin.
En 1550, Louis Meigret rédige la première grammaire française et propose une orthographe phonétique. L’écriture apportera une évolution graphique importante ; on cherche à s’entendre sur une graphie similaire pour tous. Surtout, l’invention de l’imprimerie apportera de nouvelles règles importantes. Dans les serments de Strasbourg, vous aviez remarqué l’inexistence de la ponctuation, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est à cause de l’imprimerie qu’elle devient nécessaire afin de rendre les pauses et les intonations, que la langue parlée produit naturellement. Des signes comme le point, le demi-point, le guillemet naissent, et parfois disparaissent ou se transforment.
Si vous avez visité la Rome antique, vous avez sans doute remarqué, sur les monuments impériaux, des V là où on aurait aujourd’hui un U. En effet, ce n’est qu’en 1718 que les lettres J et V sont différenciées du l et du U.
On se retrouve en 1740, où une réforme fait qu’un mot sur trois change d’orthographe, et que les accents apparaissent : throne devient trône, escrire devient écrire, et fiebvre, fièvre. Et l’évolution continue, avec des refus et objections chaque fois, jusqu’à 1990, date de la plus récente rectification orthographique. Nous en reparlerons en temps et lieux.
Ainsi, au début du XlXesiècle, l’écriture devient plus scientifique et l’étymologie prévaut sur la phonétique. Dans la première moitié de ce siècle, des formes archaïques se « modernisent » : j’avois, il étoit, deviennent j’avais, il était.
Après la Préface de Cromwell de Victor Hugo (1827), l’autorité cesse d’appartenir aux grammairiens pour passer aux écrivains et usagers éclairés de la langue. L’enseignement ne se fait plus en latin et en grec mais en français.
Puis, au début du XXesiècle, le trait d’union remplace l’apostrophe dans grand’mère, grand’messe, grand’rue, pour s’écrire, jusqu’à aujourd’hui, grand-mère, grand-père, etc.
On est loin de l’unanimité. Ainsi, en 1901, l’arrêté Leygues propose-t-il de tolérer des graphies multiples. Mais cette proposition ne sera jamais appliquée. Les dictionnaires ne bougent pas.
Ce n’est qu’en 1977 que l’arrêté Haby reviendra à la tâche, au sujet du tréma par exemple, en proposant des tolérances dans les dictées et concours officiels en France.
Lorsque j’étais écolière (dans les années 1950), on nous enseignait à écrire « poète », mais quand j’avais fait remarquer à ma maitresse que dans un livre, on avait écrit « poëte », elle m’avait répondu avec un soupir nostalgique que les deux graphies étaient possibles. CA